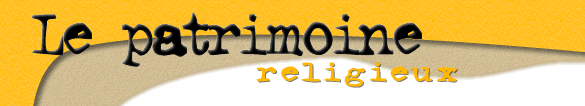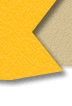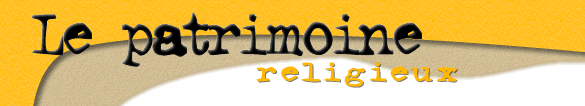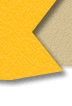|
Les premiers projets de l'édifice datent de 1927. Or, son profil général dôme, galeries-cloître , son emplacement au sommet d'une colline et dominant la ville , son programme une église haute avec crypte et un chemin de croix monumental extérieur font apparaître Lisieux comme un des derniers avatars des églises de pèlerinage du XIXè siècle. La basilique est pourtant bien un édifice du XXè siècle. L'hétérogénéité de l'édifice, le décalage entre détail et ensemble, s'explique par la longueur du chantier (1927-1975) et le nombre de mains. Ce sera l'Suvre de trois générations d'architectes lillois, les Cordonnier. Le parti architectural est dû à Louis Marie Cordonnier père (1854-1940), architecte de réputation internationale, membre de l'Institut, qui a 73 ans lorsqu'il entreprend ce projet. Il travaillera en association avec son fils, Louis Stanislas, qui continuera le chantier à la mort de son père, procédera aux restaurations nécessaires après la guerre, terminera le dôme et supervisera le chantier de décoration de l'église supérieure. Enfin, Louis, le petit-fils, prendra la suite en 1960.
Louis Marie Cordonnier a soigneusement agencé les différentes parties de l'édifice pour créer un effet de volume pyramidal particulièrement saisissant. Il a privilégié le dôme, qui devient l'élément central, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. De l'extérieur, rien ne laisse deviner le traitement du volume intérieur, scandé par une succession d'arcs diaphragmes qui rappellent les églises de la Toscane romane. C'est en progressant vers le chSur que l'on découvre l'immense espace de la croisée du transept sous la coupole, jusque-là dérobé à la vue. L'emploi du béton armé a permis d'élever une audacieuse coupole double et des grandes portées. En faisant référence à l'architecture des basiliques paléochrétiennes ou aux grands volumes des églises romanes, Cordonnier a pu mettre en valeur les volumes créés et faire référence à un type d'édifice de culte associé à la simplicité évangélique des premiers temps chrétiens et en adéquation avec la pensée thérésienne. La basilique Sainte-Thérèse est aussi à rapprocher de toute une série de grands édifices à dôme, élevés dans le monde entier au début du XXè siècle dans le courant missionnaire de l'église catholique: l'église du Souvenir Africain de Dakar, la basilique de l'Immaculée Conception à Washington, le Sacré-CSur 4e Keokelberg à Bruxelles...
|
Ce texte a été publié dans le dossier consacré au Pays d'Auge par la revue Vieilles Maisons Françaises (n°I73, juillet-août 1998).
Il est reproduit intégralement grâce à l'autorisation de son auteur et de la rédaction en chef de la revue.
Pour en savoir plus sur l'association Vieilles Maisons Françaises, ses objectifs et ses secteurs d'intervention, consultez la page qui lui est consacrée en cliquant ici.
Vous pouvez aussi visiter le site des VMF : www.vmf.net
|
|