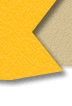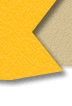|
Artistes et baigneurs séjournent d'abord
dans des auberges, puis dans les hôtels.
Mais déjà, quelques demeures privées apparaissent. La plus ancienne semble bien être celle élevée à la pointe septentrionale de la forêt
de Saint-Gatien entre 1829 et 1832 pour le poète romantique Ulric Gùttinguer, ami de Hugo, Vigny
et Sainte-Beuve. Avec son toit débordant et son vaste balcon l'édifice en pan de bois est inspiré
du chalet « à la suisse » dont le modèle, diffusé
en Europe à partir de la fin de l'Ancien Régime,
est alors très en vogue. Le chalet Gùttinguer illustre ainsi le lien qui unit la maison de villégiature
du XIXè siècle, en prise directe avec la mer
et la nature sauvage, au pavillon de fantaisie animant de son pittoresque le jardin paysager
du XVIIIè siècle.
Charles Mozin, quant à lui, se fait construire
dès 1839 un premier chalet, dénommé
Le Vieux Manoir. La notoriété de Trouville grandit peu à peu et gagne les cercles mondains
de la capitale qui trouvent dans les plaisirs
du bord de mer l'occasion d'oublier les fatigues
et les soucis de la politique ou des affaires.
La villégiature balnéaire est née et va
se développer tout au long du siècle.
En 1888, dans son roman Pierre et Jean,
Guy de Maupassant décrit la plage de Trouville comme « un long jardin plein de fleurs éclatantes. Sur la grande dune de sable jaune,[...]
les ombrelles de toutes les couleurs, les chapeaux de toutes les formes, les toilettes de toutes
les nuances, par groupes devant les cabines,
par lignes le long du flot ou dispersés çà et là, ressemblaient vraiment à des bouquets énormes dans une prairie démesurée. »
|
|