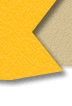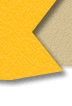|
|
 |
|

|
| |
|

|
Dans le même temps, le colombage des logis développe l'emploi de pièces obliques assemblées entre elles
et formant des motifs géométriques variés :
croix de Saint - André ou croisillons plus complexes, chevronsou feuilles de fougère.
Ce mode d'agencement a perduré dans les constructions en pan de bois du début du XIXe siècle, assez peu nombreuses au demeurant.
Les bâtiments construits dans la seconde moitié
du XIXe siècle n'emploient plus le pan de bois rompant ainsi l'étonnante homogénéité des fermes augeronnes.
Ils sont construits, comme partout ailleurs, en brique rouge cuite au charbon. Ce matériau est surtout employé pour les nouveaux bâtiments agricoles les hâloirs
pour la maturation des fromages et les distilleries
de calvados. Cependant, l'installation de ces "bouilleries" n'a pas toujours nécessité la construction d'un local spécifique l'ancien fournil délaissé construit à l'écart
de la ferme pour éviter les risques d'incendie, s'adaptait très bien à ce nouvel usage.
Certains logis ont aussi été reconstruits en brique, mais, pour satisfaire au nouveau goût, on s'est plus d'une fois contenté d'appliquer un simple parement de brique
contre la façade en pan de bois.
L'emploi du pan de bois a perduré dans les cas
de surélévation de façades.
Le chaume étant progressivement remplacé par la tuile
ou l'ardoise, il était nécessaire de réduire la pente
des toitures. Cette modification ne pouvait
se faire qu'en s'adaptant à la structure ancienne
mais l'emploi du sapin, bois scié mécaniquement, rectiligne et de plus faible section, dénonce généralement l'âge de ce surcroît. Aujourd'hui encore, les fermes
du pays d'Auge suscitent l'intérêt des horsains comme des autochtones.
De nombreux ensembles sont heureusement restaurés mais ces modifications entraînent bien souvent
la disparition des fonctions agricoles.
|
|
| |
|

|
|
|
|