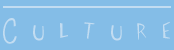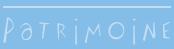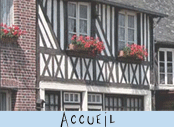
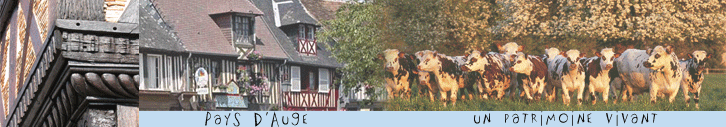

|
PATRIMOINE > Protections > Mesures de protection > Les monuments historiques
LES MONUMENTS HISTORIQUES
La loi institue deux degrés de protection en fonction des caractéristiques et de la valeur patrimoniale du monument : le classement et l'inscription. Dans le premier cas, on demande le plus souvent l'accord du propriétaire, et toute transformation de l'immeuble classé doit être soumise à l'autorisation du ministre de la Culture. En revanche, le propriétaire peut bénéficier de l'aide de l'Etat pour la remise en état, qui peut s'élever de 40 à 50 % du coût des travaux. D'autres mesures fiscales sont possibles sous certaines conditions. L'inscription est de portée plus restreinte ; toutefois dans ce cas le projet de démolition est soumis à l'accord conforme du ministre et l'Etat peut aider le propriétaire en subventionnant 10 à 15 % du montant des travaux. LA PROTECTION AU TITRE DE MONUMENTS HISTORIQUES La procédure de classement est lourde : le dossier est établi par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (Conservation régionale de monuments historiques) ; il est instruit sous l'autorité du préfet de région qui demande leur avis aux Monuments historiques, à l'architecte des Bâtiments de France (ABF), à l'architecte en chef des Monuments Historiques (ACMH), à l'inspecteur des Monuments historiques (IMH) ; le dossier passe ensuite devant la COREPHAE. S'il est accepté, le préfet prend un arrêté d'inscription à titre conservatoire et transmet le dossier au ministre de la Culture qui le soumet pour avis à la Commission supérieure des Monuments historiques (CSMH). La décision est ensuite publiée au Journal Officiel et portée sur la liste départementale des monuments classes. La protection systématique des abords des monuments a été instituée par la loi du 25 février 1943 : tous les travaux prévus à moins de 500 mètres du monument sont examinés par l'ABF, qui veille à ce qu'il n'y ait pas d'atteinte visuelle au bâtiment. Il existe aujourd'hui 40 000 bâtiments protégés dont un tiers sont classés et les deux autres tiers inscrits à l'Inventaire. LES IMMEUBLES La protection des immeubles au titre des monuments historiques relève de la loi du 31 décembre 1913 (art. 1 à 13 ter). Elle institue deux mesures distinctes en fonction de la valeur patrimoniale du monument : - « les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public » (art. 1) peuvent être classés en totalité ou en partie. La loi s’applique aux immeubles monumentaux au sens classique du terme, aux éléments du patrimoine industriel et rural, aux ensembles paysagers comme les jardins. Si les critères retenus limitent peu le champ de la protection, il est difficile en pratique de classer ou d’inscrire des édifices d’intérêt essentiellement local (lavoirs, pigeonniers…). LA PROCEDURE Elle est organisée par décret du 18 mars 1924, modifié par décret du 15 novembre 1984. En cas de décision d’inscription le Préfet de région émet un arrêté d’inscription (l’accord du propriétaire n’étant pas indispensable). En cas de classement, le propriétaire est invité à formuler son accord par écrit. S’il refuse, l’Etat peut engager une procédure de classement d’office par décret en conseil d’Etat. La décision est publiée au Journal Officiel et portée sur la liste départementale des monuments classés. Au 31 décembre 1999, 40 432 immeubles bénéficiaient d’une mesure de protection, dont 13 982 classés et 26 450 inscrits. En Basse-Normandie on dénombre 567 monuments classés et 1 088 inscrits. LA PROTECTION DES ABORDS DU MONUMENT HISTORIQUE La loi du 25 février 1943 sur la protection des abords complète celle de 1913 (art. 13 et 13 ter). Les monuments sont indissociables de l’espace qui les entoure. Toute modification est susceptible de menacer la perception et donc la conservation des édifices. LES EFFETS DE LA PROTECTION La protection d’un immeuble assure sa pérennité et garantie sa conservation. Elle produit ainsi un certain nombre d’effets prévus par la loi de 1913. Les immeubles inscrits et classés sont ainsi soumis à un régime d’autorisation et d’information (art.9). L’immeuble classé : Il ne peut être cédé, s’acquérir par prescription ou être exproprié sans le consentement du ministère chargé de la Culture. Il ne peut être détruit, déplacé ou modifié, ni être l’objet d’un travail de réparation ou de restauration sans l’accord préalable du ministère. La demande d’autorisation doit être adressée au Directeur Régional des Affaires Culturelles de la région concernée. Le permis de construire : Il n’est pas nécessaire pour les travaux de restauration (soumis à une déclaration en mairie), mais est indispensable pour les travaux neufs. Travaux de restauration et aide financière : Le propriétaire conserve l’initiative, mais il peut obtenir le concours de l’administration pour réaliser les travaux jugés indispensables à la conservation du monument. Exécution des travaux : Lorsque le propriétaire assure la maîtrise d’ouvrage des travaux, il doit consulter l'ABF compétent territorialement. Ce dernier lui fournit une liste des entreprises aptes à réaliser les travaux. Le propriétaire attribue les marchés et en assure le règlement. L’Etat lui notifie l’aide financière demandée sous la forme d’un arrêté de subvention prit par le préfet de région après approbation de la DRAC. Travaux d’entretien : Le propriétaire est tenu d’assurer la charge des travaux d’entretien et l’ABF veille à son exécution. Il peut bénéficier d’une participation financière de l’Etat, pouvant atteindre 50 % du montant des travaux. En cas d’aide financière de l’Etat, la maîtrise d’œuvre est assurée par l’ABF. L’immeuble inscrit : Le propriétaire conserve la responsabilité totale de sa conservation et le ministère chargé de la Culture doit être informé 4 mois avant tout travail de restauration ou de réparation. DEDUCTIONS FISCALES Le propriétaire d’un édifice protégé au titre de la loi du 31 décembre 1913 bénéficie de déductions fiscales de charges liées à sa propriété : CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE Droit français : - Loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques. Droit européen : - Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe, dite de Grenade, du 3 octobre 1985, approuvée en France par la loi du 23 décembre 1986. |