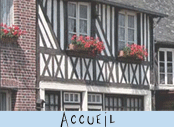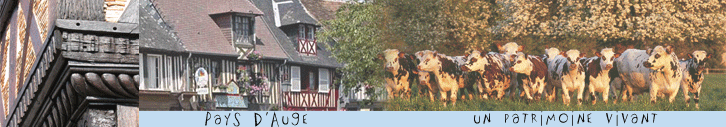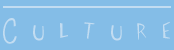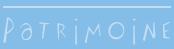PATRIMOINE > Identités patrimoniales > Patrimoine bâti > Fermes en pan de bois
FERMES EN PAN DE BOIS
ISABELLE LETTERON
Chercheur au service de l'inventaire, doctorante
La ferme augeronne comporte un clos herbeux, planté de pommiers et de quelques poiriers, sur lequel sont dispersés les bâtiments d'exploitation et le logis, bâtis en pan de bois et torchis.
Nichée au fond d'un vallon ou accrochée à flanc de coteau, la ferme augeronne ne se dévoile pas au premier regard. Il faut, pour la découvrir, parcourir les chemins creux et la deviner derrière les haies vives qui l'entourent. Elle ne comporte pas de véritable cour mais un clos herbeux, planté de pommiers et de quelques poiriers, sur lequel sont dispersés sans ordre particulier les bâtiments d'exploitation et le logis. Des fermes plus modestes ne comprennent qu'un bâtiment et regroupent, sous le même faîte, les fonctions agricoles et le logement.
La reconstruction des fermes étant liée à la prospérité économique apportée par l'embouche, la majorité des bâtiments conservés date des XVIIe et XVlIIe siècles. La conversion du pays d'Auge à ce mode d'élevage à partir de la fin du XVIe siècle a modelé le paysage bocager et a donné une certaine spécificité à la ferme augeronne. L'absence de grange est l'élément le plus évident, mais le clos augeron ne renferme pas non plus de grandes étables puisque les bœufs d'embouche ne séjournaient que peu de temps en pays d'Auge. L'étable, à proximité du logis, était donc destinée aux quelques vaches laitières et aux chevaux, quand ceux-ci ne bénéficiaient pas d'une écurie séparée. En revanche, chaque herbage possédait une petite étable pour que les bœufs s'y abritent et qu'un complément de fourrage puisse leur être apporté.
Les autres bâtiments du clos sont liés à la cidriculture qui s'est développée parallèlement à l'embouche par le complantage des herbages. Le pressoir, bâtiment imposant, renferme la presse à longue étreinte, et le « tour à pomme », auge circulaire d'abord construite en bois puis en granit, dans laquelle les pommes sont broyées avant d'être pressées. Une trappe permet d'y faire tomber les fruits stockés dans le grenier. Le cellier ou cave, souvent accolé au pressoir, abrite les tonneaux de cidre. Le logis ne se distingue pas toujours au premier abord des autres constructions. Il ne comporte généralement qu'un niveau avec parfois une pièce aménagée dans le comble. La salle commune est la seule pièce chauffée. L'accès au comble se fait par un petit escalier tournant en bois logé près de la cheminée. Cependant, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les plus riches des herbagers ont fait reconstruire leur demeure, à l'imitation des manoirs. Plus spacieuse, elle comporte un étage desservi par un escalier tournant plus monumental et construit au centre du logis. Les massifs de cheminée symétriques permettent de chauffer les deux grandes pièces par niveau. Enfin, ce logis se signale par la régularité de ses percements.
LE PAN DE BOIS
Logis et dépendances sont bâtis en pan de bois et torchis. Les bâtiments conservés ont une ossature simple associée à un colombage serré. Les poteaux de forte section font la hauteur du bâtiment, que celui-ci comporte ou non un étage. Ils reposent sur de grosses pierres de soubassement, et un mur solin en moellon supporte la sablière basse assemblée à tenon et mortaises dans les poteaux. Dans les bâtiments agricoles, les sommiers sont assemblés dans les poteaux soit à tenon traversant chevillé par deux clavettes, soit à enfourchement, la tête du sommier saillant alors sur l'extérieur. Ce mode d'assemblage ne se rencontre que rarement sur le logis, où le sommier est assemblé dans la face interne du poteau.
Au XVIe et au XVIIe siècle, l'écartement des pièces du pan de bois est à peu près équivalent à la largeur d'une colombe. Cet écartement augmente progressivement au cours des XVIIIe et XIXe siècles pour correspondre à la largeur de deux colombes. Le colombage élancé fait la hauteur d'un étage, sans être interrompu par une sablière intermédiaire. Cependant, il est souvent renforcé par une lisse, pièce de bois horizontale appliquée contre la paroi et chevillée sur chaque colombe. Dans les rares bâtiments du XVIe siècle conservés, les écharpes, pièces obliques de contreventement, sont dissimulées au revers de la façade, ne laissant visible qu'un colombage strictement vertical. Au XVIIe siècle, ces écharpes deviennent visibles et coupent les colombes. Elles vont se multiplier au cours du XVIIIe siècle : trois ou quatre, voire cinq pièces courbes ou droites sont groupées dans les angles formés par les poteaux et les sablières. Les charpentiers augerons ont su tirer parti des bois courbes pour ces pièces obliques, renforçant ainsi leur résistance.
Dans le même temps, le colombage des logis développe l'emploi de pièces obliques assemblées entre elles et formant des motifs géométriques variés : croix de Saint-André ou croisillons plus complexes, chevrons ou feuilles de fougère. Ce mode d'agencement a perduré dans les constructions en pan de bois du début du XIXe siècle, assez peu nombreuses au demeurant. Les bâtiments construits dans la seconde moitié du XIXe siècle n'emploient plus le pan de bois rompant ainsi l'étonnante homogénéité des fermes augeronnes. Ils sont construits, comme partout ailleurs, en brique rouge cuite au charbon. Ce matériau est surtout employé pour les nouveaux bâtiments agricoles les hâloirs pour la maturation des fromages et les distilleries de calvados. Cependant, l'installation de ces « bouilleries » n'a pas toujours nécessité la construction d'un local spécifique l'ancien fournil délaissé construit à l'écart de la ferme pour éviter les risques d'incendie, s'adaptait très bien à ce nouvel usage. Certains logis ont aussi été reconstruits en brique, mais, pour satisfaire au nouveau gožt, on s'est plus d'une fois contenté d'appliquer un simple parement de brique contre la façade en pan de bois.
L'emploi du pan de bois a perduré dans les cas de surélévation de façades. Le chaume étant progressivement remplacé par la tuile ou l'ardoise, il était nécessaire de réduire la pente des toitures. Cette modification ne pouvait se faire qu'en s'adaptant à la structure ancienne mais l'emploi du sapin, bois scié mécaniquement, rectiligne et de plus faible section, dénonce généralement l'âge de ce surcroît. Aujourd'hui encore, les fermes du pays d'Auge suscitent l'intérêt des horsains comme des autochtones. De nombreux ensembles sont heureusement restaurés mais ces modifications entraînent bien souvent la disparition des fonctions agricoles.
|