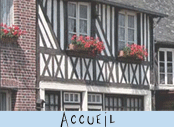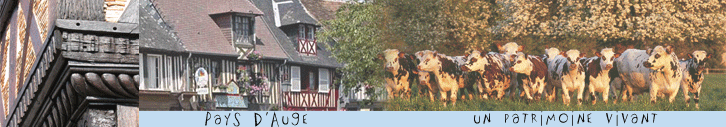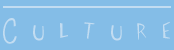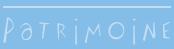PATRIMOINE > Identités patrimoniales > Patrimoine bâti > Le Manoir en Pays d'Auge
LE MANOIR EN PAYS D'AUGE
YVES LESCROART
Conservateur en chef du Patrimoine
Le pays d'Auge et la seule région où le pan de bois à connu ses lettres de noblesses dans l'architecture seigneuriale. Le manoir, ou plutôt l'enclos manorial, comporte le logis avec ou sans dépendances, la basse-cour et parfois la chapelle.
Le pays d'Auge offre un champ de connaissance exceptionnel pour l'étude de l'architecture civile en France, par la densité et la qualités des témoins conservés sur ce terroir. Il faut y ajouter le goût immodéré de ses bâtisseurs pour la mise en œuvre des matériaux les plus divers, la pierre, la brique et surtout le bois, qui a trouvé ses expressions les plus raffinées, de la fin du Moyen Âge aux dernières années de l'Ancien régime. Si l'architecture urbaine française compte encore tant de maisons de bois, le pays d'Auge et la seule région où ce matériau à connu ses lettres de noblesse dans l'architecture seigneuriale.
Les recherches développés au cours des dernières années ont redonné au manoir sa véritable signification, mettant fin à l'amalgame incertains des « manoirs-fermes », « maisons fortes » et autres « fermes-châteaux » pour lui restituer sa véritable identité, à savoir celle de chef-lieu de seigneurie, échelon de la structure féodale. A ce titre, le manoir exprime à la fois l'entité politique et économique de la portion de territoire tenue en foi et hommage du suzerain par son vassal, seigneur du lieu.
Le manoir est à la foi la demeure ordinaire du seigneur et de sa famille et le siège de l'exploitation agricole qu'il gère directement avec ses serviteurs — la réserve seigneuriale, ou domaine non fieffé, limité à ses stricts besoins —, distinct du domaine fieffé, confié à des tenanciers qui à leur tour seront en quelque sorte ses vassaux. Le manoir doit être aussi le signe tangible du rang social de son seigneur, le signe des droits et prérogatives attachés au fief, qui doivent s'imposer sans équivoque. Droit de se fortifier — de manière symbolique le plus souvent —, prérogative d'y recevoir l'hommage de son vassal lorsqu'un fief change de main, d'y exercer son droit de justice, ou d'exercer ses « droits utiles ordinaires » comme le droit de colombier, si précisément codifié dans la Coutume de Normandie.
Ainsi se dessinent les trais dominants du « manoir » ou plutôt de l'enclos manorial : le logis avec ou sans dépendances, à l'origine simple tour carrée en bois juchée sur la motte de terre cernées de fossés et de défenses légères, la basse-cour plus sommairement défendue, contenant les communs, greniers, étables, écuries, souvent centrée sur le colombier, et, parfois, la chapelle.
UNE DUALITÉ MARITIME ET CHAMPÊTRE
Le manoir du Désert à Honfleur, est l'un des archétypes de cette catégorie d'édifices, probablement l'un des mieux préservés. Le domaine a été constitué au lendemain de la guerre de Cent Ans par la famille Le Danois, qui a investi dans cet essard de la forêt de Touques une part des revenus de son activité principale de grands navigateurs. Cette dualité entre l'aventure maritime et la paisible maison des champs n'est pas le moindre charme du manoir du Désert perceptible dans l'implantation du domaine au rebord du plateau surplombant la ville et l'estuaire de la Seine.
Dualité du caractère paisible de cet enclos rural et du caractère défensif de cette modeste enceinte ; dualité encore dans l'étonnante architecture de ce logis : s'attendrait-on à trouver sur cet important rez-de-chaussée solidement maçonné, finement appareillé de calcaire et de silex en damiers irréguliers, un étage à pan de bois au volume élancé ? Le premier niveau nous rattache à une tradition terrienne, à la rigueur sobre et au lignes strictes, le second nous entraîne vers les audaces des maîtres de hache de l'architecture navale, jusqu'à cette chambre de veille posée au sommet de la tour de l'escalier, et que le vent du large semble avoir fait chanceler.
La principale originalité de ce logis réside dans la dissociation de l'escalier et de la galerie ouverte de l'étage, situés habituellement tous deux sur la façade arrière. La prestance symbolique de la tour sur la façade principale, dans laquelle s'ouvre l'accès d'honneur, a sans doute beaucoup compté dans ce choix. Au Désert, nous découvrons une harmonie particulière en demi-teinte, sans l'éclat de la couleur, en un point ou la situation maritime et l'influence des permis voisins ont permis une expression originale dans l'art de bâtir. Harmonie beige, faite du rose brun et de l'ocre pâle de l'ample toiture, harmonie contrasté et rude des damiers de calcaire et de silex éclaté brun et noir — ramené des rivages ou tirés du plateau. Harmonie plus classique des bois brunis et grisés par le temps, dont l'austérité s'estompe en une variété de forme dominée par la « vigie » sur l'escalier, et la galerie — appelons-la « coursive » — de la façade arrière.
Symboles de la dualité de cette demeure, maison des champs d'un coureur d'océans, les précieux graffiti de navires, tracés çà et là d'une pointe mal assurée sur le hourdis de chaux ou les pierres d'un contrefort, nous ramène cinq siècles plus tôt, à l'époque où Binot Paulmier de Gonneville, qui fréquenta sans doute Le Désert en voisin, quittait son manoir du Buquet pour aborder les terres vierges du Brésil.
VIRTUOSITÉ TECHNIQUE ET DÉCORATIVE
Plus ancré à la terre, le manoir de La Planche développe dans des proportions inusitées ce premier schéma de logis. Son impressionnant volume se détache sur une large plaine alluvial, sans autre relief que les arbres bordant les ruisseaux, dressant une silhouette altière accentuée par la simplicité de lignes qu'une soigneuse restauration lui à restituées. Ses deux niveaux sont coiffée d'une ample toiture de tuiles, recoupée non par quelques lucarnes aux dimensions mesquines, mais par la saillie de la tour d'escalier de la façade arrière, au sud, et la grande lucarne unique de la façade nord, véritables pignons de charpente érigée à l'aplomb d'une énorme souche de cheminée centrale. Les faîtages s'y entrecroisent et pas un pan coupé ne vient adoucir cette formidable verticalité. Dans le même esprit, une galerie ouverte dessert les pièces de l'étage, porté par le surplomb des sommiers des plafonds, épaulés par des robustes aisseliers.
La façade nord, sur la cour, adopte la composition traditionnelle de la fin du Moyen Âge, dictée par la présence du massif de cheminées, reportant les portes aux angles des deux pièces principales du rez-de-chaussée. Le logis du manoir de La Planche possède une troisième pièce à ce niveau, desservie également par une porte ouverte sur l'extérieur, à l'extrémité ouest. Chacune d'elle est éclairée par une fenêtre à meneau et traverse, adjacente à un poteau de travée ou percée en milieu de travée. L'encorbellement qui sépare les deux premiers niveaux est traité avec un soin exceptionnel et témoigne d'une véritable virtuosité, tant sur le plan technique que dans son principe décoratif. Il appartient à la catégorie des encorbellements sur sommiers, qui font ici une légère saillie adoucie par une taille en quart-de-rond.
Le décor est particulièrement soigné : le surplomb de la lucarne est porté par un encorbellement aux entretoises ornées de rageur grimaçants, les deux fenêtres s'ouvrent au dessus d'une allège en croix de Saint-André, et le gable est souligné d'une ferme débordante, au poinçon sculpté d'une salamandre.
Cette abondance contraste avec la sobriété du reste de la façade, où les poteaux se contentent de deux petits culots à la naissance de l'épaississement destiné à soulager le débord des sommiers, ou ménager le passage de la lisse d'appui à l'étage. Les accolades des portes secondaires restent discrètes réservant tout le soin à celle de l'angle nord-est. On y trouve tout ce qui peut donner quelque apparat à cette ouverture, donnant accès à la grande salle seigneuriale : deux contreforts couronné de pinacle effilés, taillés dans la masse des poteaux, encadrent l'accolade à feuilles dentelées et son fleuron à crochets, protégeant l'écu autrefois peint aux armes du seigneur de La Planche...
LES RÈGLES DE STABILITÉ DE LA FIN DU XVe
Le logis du manoir de La Brairie semble à première vue composé de deux constructions jumelées, presque identiques dans leurs structures, en décrochement de quelques centimètres l'une de l'autre, et présentant une rupture franche au niveau de la toiture. Il n'en est rien. Le maître d'œuvre qui à conçu ce logis à simplement respecté les règles de stabilité qui prévalaient à la fin du XVe siècle. La cohésion de la construction était assurée par la sablière basse d'étage, toujours taillée dans une unique pièce de bois. Dans l'impossibilité d'en trouver une d'une telle longueur, le charpentier a donc préféré juxtaposer deux structures totalement indépendantes pour réaliser un seul logis.
L'originalité de cette construction réside dans le traitement du pignon, largement percé de six fenêtres à l'étage, auxquelles répond l'impressionnante séries de baies juxtaposées sur la façade principale. Si une telle disposition du pignon est exceptionnelle en milieu rural, elle l'est beaucoup moins en milieu urbain, et la ville de Lisieux toute proche comptait encore avant 1944 plusieurs constructions très proches de celle-ci, au point d'y voir peut-être l'intervention d'un même maître d'œuvre.
Le logis du manoir des Pavements révèle une heureuse synthèse des dernières traditions gothiques et des apports ornementaux de la renaissance, remarquablement assimilés par le maître d'œuvre de la famille de La Reue. Il a conçu la façade principale sur la base d'un tracé régulateur très élaboré, qui lui a donné ses lignes harmoniques, à peine estompé par un bel essentage de tuile. L'axe de symétrie est donné par un poinçon de la grande lucarne centrale, et la hauteur de la charpente du comble est égale à la hauteur du pan de bois des deux niveaux.
La modénature et la sculpture viennent très fortement rappeler que si le volume général de l'édifice et quelques détails sont encore empreints de l'esprit gothique, comme des linteaux des portes de la façade ouest avec leurs accolades semées de choux frisés et couronnées de fleurons les ornemanistes ont entamé le renouvellement du répertoire amorcé avec magnificence dans les grands chantiers de la Renaissance. A l'encorbellement tout d'abord : les robustes moulures rondes du XVe ont fait place à de fines doucines et talons séparés de minces baguettes, redécoupées en denticules en parties hautes. Sous l'accolade des portes, les habituelles colonnettes ont fait place à des pilastres très plats à peine marqué par un léger défoncé bordé d'une doucine, supportant des chapiteaux corinthiens ou les volutes émergent d'une corbeille à feuillages stylisés.
Ces faibles reliefs, ces moulures nerveuses, quelque peu érodés par le temps, contraste avec la sculpture toutes en courbes pleines qui se déploie ordinairement sur l'entretoise de l'encorbellement. Les « rageurs » du siècle précédent, dont la gueule ouverte engloutissait les abouts de poutre, ont ici pris la forme de gracieux dauphins, de poissons aux formes contournées ou de monstres marins se muant en feuillages.
UNE ARCHITECTURE DE LA COULEUR
Le manoir de Querville s'ordonne en une cour polygonale, cernées primitivement de fossé en eau, à laquelle on accède par une poterne maçonnée en damiers irréguliers de calcaire et de brique. Les dépendances, étables, granges, pressoir, appentis s'adossent encore aux murailles, encadrant un somptueux logis de bois porté par un premier niveau de brique et de pierre. Il n'y manque que le colombier, situé dans une avant-cour, et dont les soubassements de pierre ont disparu depuis plusieurs décennies.
Le logis se donne de prime abord une image d'unité, que lui confère sur la cour l'ample volume de sa toiture percée de trois lucarnes et un premier niveau d'une maçonnerie très soignée, alternant une somptueuse tapisserie de brique semée de losanges d'abouts vernissés de part et d'autre de la porte axiale et les chaînes et jambes harpées en calcaire légèrement doré. En fait le goût de l'époque a fait du modeste logis médiéval en bois une demeure confortable. Les trois travées gothiques ont été conservées, bien visibles sur la façade arrière, et somptueusement remaniées à la Renaissance.
Le pan originel de la façade sur cour ne subsiste qu'à l'étage, prolongé par une structure de bois beaucoup plus simple au delà de la porte centrale à fronton de pierre.
L'effet de polychromie est bien présent à Querville, opposant le calcaire, la brique et le bois. Quelques abouts de brique vernissés, quelques tuiles à glaçure jaune ou verte sur les toits sont là pour nous rappeler la place que tenait la couleur dans les attraits de Querville. Il portait d'admirables épis de faîtage, déposés au début de ce siècle, mais aussi des tuiles faîtières vernissées à décors de rinceaux et feuillages stylisés, identiques à ceux que l'on trouvait sur les pavages encore soigneusement préservés.
Les châteaux de Saint-Germain-de-Livet et de Victot avaient montré la voie, en illustrant somptueusement une architecture de la couleur fondée sur la polychromie de la pierre, de la brique et de la terre cuite vernissée. Cependant, même si la construction en brique et pierre prend son essor au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, les charpentiers ont fait œuvre créatrice jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Le logis des Quatre-Nations en est l'un des plus beaux fleurons. Les murs de bois sont percés de larges fenêtres au linteau cintré, les portes sont ornées de panneaux chantournés, les impostes rivalisent de motifs curvilignes. A la rigueur des ossatures puissantes des siècles passés, l'épure du charpentier multiplie désormais les motifs de croisillons, de feuilles de fougère, bannissant tout motif sculpté au profit du foisonnement des pièces obliques.
La lecture architecturale de ces manoirs est souvent plus complexe que ne veulent bien le laisser croire les premières esquisses ci-dessus. Il suffit pour s'en convaincre d'analyser des ensembles apparemment simples, comme le manoir de Coupesarte. Du logis primitif ne subsiste que l'ossature de la fin du Moyen Âge, regarnie d'un colombage en harmonie avec une nouvelle aile bâtie en retour d'équerre sur la cour un siècle plus tard.
Au manoir des Evêques, à Canapville, la reconstruction au sortir de la guerre de Cent Ans s'est faite progressivement, en réutilisant les quelques vestiges encore intacts, déjà remaniés lors de l'occupation anglaise. Au manoir de Bellou, l'apparente unité de l'ample logis est brouillée par l'usage en réemploi précoce d'éléments de façade entiers, selon une pratique généralisée propre à la construction à pan de bois. Au manoir du Bais, les maîtres d'œuvre successifs ont fait alliance des robustes charpentes du premier bâtisseur du logis, puis manié la géométrie sévère du damier sur la poterne, joué ensuite la dissimulation en habillant de brique pilée le pan de bois de l'antique demeure médiévale, allant enfin jusqu'à travestir le vénérable colombier en une fabrique romantique posée au bord des douves. De l'observation hâtive de ces ensembles prestigieux est parfois née l'illusion de constructions entreprises avec un goût marqué pour la fantaisie et l'asymétrie. L'analyse rigoureuse nous conduit à découvrir des ensembles conçus sur la base de programmes extrêmement élaborés, dans lesquels les maîtres d'œuvre n'ont cessé d'apporter une lecture renouvelée, faite de solides traditions et d'une constante ouverture à l'innovation. Comment ne pas reconnaître enfin à ces manoirs du pays d'Auge une qualité essentielle, celle d'être le fruit d'une subtile alliance entre un terroir généreux de ses bois, de ses eaux, de ses terres, et des hommes qui ont su le comprendre et l'aimer.
|