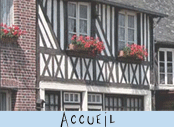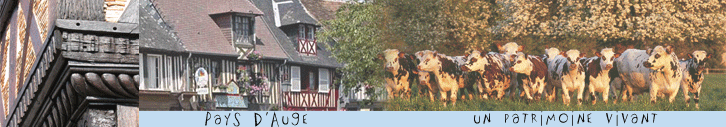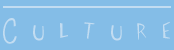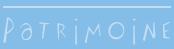PATRIMOINE > Identités patrimoniales > Patrimoine côtier > Les charmes de la villégiature
LES CHARMES DE LA VILLÉGIATURE
HERVÉ PELVILLAIN
Conservateur régional de l'inventaire général de Basse-Normandie
Trouville, Deauville, Cabourg, Houlgate, les stations balnéaires de la Côte fleurie sont célèbres dans le monde entier. Des villas éclectiques, régionalistes, toutes assurément pittoresques, ont été bâties dès le début du siècle pour ceux qui furent séduits par ces nouveaux lieux de villégiature.
Renommé pour ses paysages vallonnés et verdoyants, ses herbages complantés de pommiers et ses constructions en pan de bois, le pays d'Auge est célèbre dans le monde entier pour son littoral Trouville, Deauville, Cabourg... De l'estuaire de la Seine à l'embouchure de la Dives, la Côte fleurie possède un ensemble de stations balnéaires prestigieuses dont le seul nom suffit à évoquer les fastes ou les charmes de la villégiature du bord de mer. Ce littoral, qui présente une alternance de falaises argileuses et de zones basses sableuses, semblait pourtant a priori peu favorable à l'urbanisation. Au début du XIXe siècle, à l'exception des petits ports de pêche abrités à l'embouchure de la Touques ou de la Dives, les villages des communes littorales étaient encore implantés en retrait d'un rivage demeuré sauvage. Mais c'est précisément le caractère sauvage du paysage qui va attirer les artistes auxquels la côte augeronne doit l'origine de sa fréquentation.
LA REINE DES PLAGES
En 1825, à l'âge de 19 ans, le peintre Charles Mozin découvre Trouville. Dès 1827, il en expose au Salon une première vue intitulée Effet de neige au bord de la mer. Très vite, d'autres artistes le rejoignent dans sa « terre promise ». Alexandre Dumas y séjourne en 1831, bientôt suivi par Alphonse Karr, Paul Huet, Eugène Isabey et Gustave Flaubert.
Avec les peintres et les écrivains, les médecins ont joué un rôle déterminant dans le développement de la mode balnéaire. A leurs yeux en effet, l'eau saline et l'air iodé trouvent des vertus innombrables. Les guides médicaux, qui se multiplient dans la première moitié du XIXe siècle, recommandent le séjour marin. La pratique des bains de mer devient l'élément essentiel d'une cure reconstituante et fortifiante.
Artistes et baigneurs séjournent d'abord dans des auberges, puis dans les hôtels. Mais déjà, quelques demeures privées apparaissent. La plus ancienne semble bien être celle élevée à la pointe septentrionale de la forêt de Saint-Gatien entre 1829 et 1832 pour le poète romantique Ulric Gùttinguer, ami de Hugo, Vigny et Sainte-Beuve. Avec son toit débordant et son vaste balcon l'édifice en pan de bois est inspiré du chalet « à la suisse » dont le modèle, diffusé en Europe à partir de la fin de l'Ancien Régime, est alors très en vogue. Le chalet Gùttinguer illustre ainsi le lien qui unit la maison de villégiature du XIXe siècle, en prise directe avec la mer et la nature sauvage, au pavillon de fantaisie animant de son pittoresque le jardin paysager du XVIIIe siècle. Charles Mozin, quant à lui, se fait construire dès 1839 un premier chalet, dénommé Le Vieux Manoir.
La notoriété de Trouville grandit peu à peu et gagne les cercles mondains de la capitale qui trouvent dans les plaisirs du bord de mer l'occasion d'oublier les fatigues et les soucis de la politique ou des affaires. La villégiature balnéaire est née et va se développer tout au long du siècle. En 1888, dans son roman Pierre et Jean, Guy de Maupassant décrit la plage de Trouville comme « un long jardin plein de fleurs éclatantes. Sur la grande dune de sable jaune, [...] les ombrelles de toutes les couleurs, les chapeaux de toutes les formes, les toilettes de toutes les nuances, par groupes devant les cabines, par lignes le long du flot ou dispersés çà et là, ressemblaient vraiment à des bouquets énormes dans une prairie démesurée. »
URBANISATION DE LA CÔTE FLEURIE
C'est au milieu du siècle dernier que naissent les principales autres stations balnéaires du littoral augeron : Cabourg en 1853, Houlgate en 1858 et Deauville en 1859. Les modalités de leur création reproduisent un schéma identique un homme d'affaires et un notable s'associent à un homme politique pour fonder une société destinée à acquérir les terrains à lotir. Ainsi le banquier parisien Vergnolle, l'avocat lexovien Delise et le député Amédée René à Houlgate ou le banquier Donon, le médecin Oliffe et le duc de Morny à Deauville. La transaction est parfois longue et difficile, la propriété des terrains incultes du bord de mer étant souvent incertaine.
Pour les fondateurs, il s'agissait avant tout de réaliser une opération foncière et immobilière. Mais, très tôt, les guides balnéaires ont teinté de merveilleux une réalité économique plutôt terre à terre en présentant les premiers spéculateurs comme les inventeurs d'un nouvel Eldorado. Voici comment fut rapportée, en 1882, la découverte du site de Cabourg par Durand-Morimbau, agent d'affaires de Paris, et son ami, Collin. Par une belle soirée du mois de septembre, deux touristes arrivaient à Dives, après avoir suivi toute la côte depuis Trouville. Épuisés de fatigue, ils allaient entrer à l'hôtellerie Guillaume-le-Conquérant pour y passer la nuit, lorsque l'un d'eux, obsédé par une idée fixe, voulut pousser jusqu'à la plage de Cabourg. Frappé par la beauté du site, « il revint enthousiasmé à l'hôtellerie, et le lendemain les deux amis allèrent explorer la plage et les environs. [...] De retour à Paris, M. Durand-Morimbau eut bientôt formé pour l'établissement de sa colonie balnéaire une société qui prit le nom de Société thermale. »
Le chemin de fer, qui atteint Trouville dès le 1er juillet 1863, améliore considérablement les conditions d'accès depuis Paris. Il va ainsi permettre le rapide essor de l'urbanisation du littoral. On assiste alors à une véritable colonisation des plages de Normandie. Créées à la même époque et dans un même contexte, les stations de la Côte fleurie possèdent néanmoins une identité propre. Certaines sont animées et mondaines comme Trouville, Deauville et Cabourg, d'autres calmes et familiales comme Villers et Houlgate. Les groupes sociaux s'y rassemblent selon leurs affinités politiques légitimistes à Villers, orléanistes à Trouville, bonapartistes à Deauville et républicains à Houlgate ou à Cabourg. De même, la diversité des sites occupés a suscité l'émergence de formes urbaines variées. Dans les zones de falaises comme à Villers ou à Houlgate, on a surtout privilégié la recherche des effets pittoresques. L'étagement des constructions sur les coteaux a permis de multiplier les points de vue sur la mer ou sur la campagne. Les zones plates, en revanche, ont favorisé le développement d'un urbanisme élaboré organisé par les relations entre les équipements structurants que sont les casinos, les établissements de bains et les grands hôtels. Le plan de Cabourg est remarquable par son éventail d'avenues rayonnantes convergeant vers la mer.
PITTORESQUE, ÉCLECTISME ET RÉGIONALISME
Comme le signalent les nombreux guides destinés à la promotion des stations et les recueils d'architecture à l'usage des professionnels, ce sont les villas qui constituent les véritables « monuments » des cités du bord de mer. A l'image des pavillons des expositions universelles, dont certains ont d'ailleurs été transplantés sur la côte normande, la demeure de villégiature représente, dans la seconde moitié du XIXe siècle et les premières décennies du XXe siècle, un champ exceptionnel d'expérimentation architecturale. Volume cubique, élévations symétriques et toit à quatre versants, ou parfois comble brisé les plus anciennes maisons sont, pour la plupart, sobres et de dimensions moyennes. Mais parallèlement à ce type très répandu jusqu'à la fin du second Empire, des constructions plus imposantes apparaissent à Trouville dès les années 1840. La villa réalisée par Quantinet pour le comte d'Hautpoul en 1842, inspirée du classicisme du début du XVIIe siècle, est comparée à un « petit château ». La grande demeure que construit l'architecte de Gisors pour lui-même en 1846 est qualifiée de « pavillon Renaissance ».
En recomposant les formes architecturales européennes des siècles précédents et en jouant avec les effets polychromes des matériaux employés, ces architectes prônaient une esthétique nouvelle en rupture avec l'architecture néo-classique, et leurs œuvres annoncent plusieurs décennies de création. Une architecture de fantaisie forme alors à l'arrière des plages un décor qui sert de cadre aux plaisirs et aux fêtes. L'inspiration historiciste voit fleurir hôtels gothiques, palais à l'italienne ou maisons hollandaises. La tendance pittoresque multiplie les chalets, tandis qu'un courant exotique donne naissance à des édifices comme la Villa persane de Trouville.
La recherche presque systématique du pittoresque caractérise l'évolution de l'architecture dans le dernier tiers du XIXe siècle. Les plans se diversifient, les volumes s'emboîtent avec science, les matériaux employés sont plus variés et le décor architectural plus abondant. Les toitures deviennent complexes et ornées. Si, par sa monumentalité et son originalité, la maison de villégiature affirme désormais l'importance sociale de son propriétaire, elle est aussi la marque de l'ingéniosité des architectes. Ainsi, à Cabourg, les villas qui bordent les jardins du casino semblent différentes. En réalité, toutes possèdent un plan analogue et combinent des volumes semblables. Mauclerc, leur maître d'œuvre, a dissimulé l'emploi répété d'une formule type en jouant avec les matériaux utilisés, l'agencement des volumes entre eux et l'orientation des façades par rapport à la place.
Les constructions augeronnes en pan de bois, rurales ou urbaines, ont été une source d'inspiration précoce pour les architectes du littoral. A Trouville, le second chalet Mozin est construit dès 1846 et la maison normande du député Cordier en 1866. A Houlgate, la villa Suzanne est élevée en 1860. L'architecture néo-normande semble donc être la première architecture régionaliste française. D'abord très proche des modèles locaux, notamment des demeures anciennes de Lisieux, elle s'en libère peu à peu pour donner naissance à un style autonome, qualifié d'anglo-normand et largement diffusé en dehors de la Normandie.
Un épisode encore trop peu connu du courant régionaliste est celui qui a consisté, à partir des années 1930, à habiller d'un faux pan de bois les demeures éclectiques du siècle précédent. Ce mouvement a été initié par Fernand Moureaux, maire de Trouville depuis 1934, qui souhaitait affirmer le caractère normand de sa commune pour mieux la distinguer des stations voisines et notamment de Deauville. Créateur et fabricant de l'apéritif Suze, il put grâce à sa fortune personnelle encourager de ses propres deniers la « normandisation » des quais.
Après un siècle de prospérité, la Côte fleurie a été peu à peu délaissée, à la fin de la première moitié du XXe siècle, au bénéfice des plages méridionales, plus ensoleillées. Ce déclin relatif a sauvé de la destruction un patrimoine bâti qui compte parmi les plus complets et les mieux conservés des côtes européennes. Témoignage exceptionnel de l'architecture d'un siècle qui fut, en ce domaine, particulièrement entreprenant, il constitue aujourd'hui le principal atout d'un littoral en plein renouveau.
|