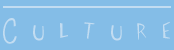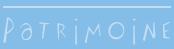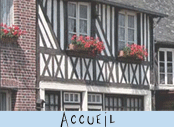
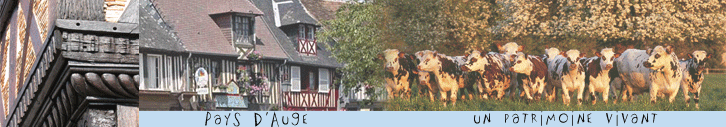

|
PATRIMOINE > Identités patrimoniales > Patrimoine religieux > Parcours médiéval PARCOURS MÉDIÉVAL JULIEN DESHAYES Les églises rurales médiévales, généralement isolées, sont blotties au creux d'un vallon ou attachées au flanc d'une colline. Parmi les abbayes ou prieurés implantés en pays d'Auge, peu ont été épargnés, mais la cathédrale Saint-Pierre de Lisieux apporte une contribution majeure à l'architecture du duché. Tout autant que les fermes ou les manoirs, les églises rurales contribuent à dessiner la physionomie bien particulière du paysage monumental augeron. Tantôt blottis au creux d'un vallon ou attachés au flanc d'une colline, ces édifices aux plans simples et aux dimensions modestes se présentent généralement isolés au sein du tissu très lâche de l'habitat des paroisses qu'ils contrôlent. De fait, les lois présidant ailleurs au phénomène du regroupement des maisons autour de l'église et de son cimetière paraissent n'avoir fonctionné ici qu'avec parcimonie. Dans cette région pourtant, plus que dans le reste de la Normandie, il nous est donné de lire l'ancienneté du réseau paroissial existant à travers la structure même des édifices conservés. A L'AUBE DE L'ÉPOQUE ROMANE A Vieux-Pont comme au choeur de Ouilly-le-Vicomte et sur la façade de Hotot-en-Auge, l'emploi d'un petit appareil relativement régulier avec arases horizontales de brique traduit, à une date voisine de l'an mile, le maintien de traditions constructives préromanes. A l'ancienne église Saint-Antonin de Montargis, à Saint-Sylvain de Glos, ou enocre à Saint-Martin-de-la-Lieue et à Saint-Jean-de-Livet, le petit appareil régulier d'origine antique est également employé, désormais associé avec des lits de pierre disposés en arête de poisson. Dans ces deux derniers édifices, le pignon occidental est en outre percé d'une série de petites ouvertures triangulaires disposées en pyramide, selon le principe des fenestellae d'époque carolingienne. VERS L'ARCHITECTURE GOTHIQUE Le bourg de Touques, initialement divisé en deux paroisses, possède une seconde église très précocément dédiée à Saint-Thomas Becket. En dépit de restaurations lourdes, cet édifice des années 1170 présente un indéniable intérêt, avec son haut vaisseau unique dont la largeur est celle d'une nef à bas-côtés. Cette conception d'un espace très dilaté, aux parois minces reste à peu près unique en Normandie. ABBAYES ET PRIEURÉS Si les altérations ou les destructions pures et simples n'ont pas épargné les édifices paroissiaux, celles-ci s'avèrent hélas bien plus funestes encore en ce qui concerne les abbayes. De même que l'abbaye des Bénédictins de Troarn, l'ancien monastère de Sainte-Barbe figure de fait parmi les grands inconnus de la région. De toutes les fondations recensées, seule l'abbatiale de Saint-Pierre-sur-Dives dresse encore une silhouette significative dans le paysage monumental augeron. Fruit de plusieurs campagnes de constructions échelonnées du XIe au XVIe siècle, celle-ci se présente aujourd'hui comme un édifice assez peu homogène. La façade elle-même, avec ses deux tours dissymétriques, l'une au nord du XIVe et l'autre du milieu du XIIe siècle, fait apparaître la difficulté que l'on semble avoir eu à en achever la reconstruction, entreprise déjà en 1108. Le désaxement très sensible des piles de la nef, plantées dans le derier quart du XIIe siècle, montre qu'il fallut tenir compte d'antécédents architecturaux difficilement assimilés. Le choeur à déambulatoire et chapelles rayonnantes conserve lui aussi, dans sa structure gothique, les traces d'un projet antérieur brutalement abandonné. L'extérieur toutefois compense cette impression d'hésitation par ses hautes surfaces de pierre brune ocrée et le bel étagement des toits du chevet. Outre des abbayes de diverses obédiences le pays d'Auge vit aussi s'implanter sur ses terres quelques importants établissements prioraux. Avant celui de Beaumont-en-Auge, le prieuré de Saint-Hymer comptait parmi les fondations les plus richement posséssionnées de la région. Son large choeur de deux travées à abside polygonale constitue un bel exemple de l'architecture du XIVe siècle en Normandie. Sur le transept sud, une chapelle de la fin de l'époque romane possède des chapiteaux finement sculptés, très comparables à ceux de Saint-Thomas de Touques. LA CATHÉDRALE SAINT-PIERRE DE LISIEUX La cathédrale Saint-Pierre de Lisieux, église mère du principal diocèse augeron, se devait d'apporter une contribution majeure à l'architecture du duché. Suite à la destruction à peu près totale de la grande église édifiée au XIe siècle, c'est à l'évêque Arnoul (1141-1181) qu'il revint d'entreprendre la construction de l'édifice actuel. S'inspirant des modèles issus du domaine capétien, l'architecture adopta un parti de nef à larges supports cylindriques et introduisit l'utilisation systématique des arcs-boutants comme principe d'épaulement des poussées latérales. En revanche, l'élévation à trois niveaux reste tributaire de la tradition normande. Le plan lui-même respecte les conditions générales de l'édifice antérieur et en conserve certaines spécificités remarquables. Il en va ainsi notamment pour le transept à bas-côtés orientaux, dont l'idée pourrait avoir été ramenée de Saint-Rémi de Reims par l'évêque Herbert (1022-1049). |